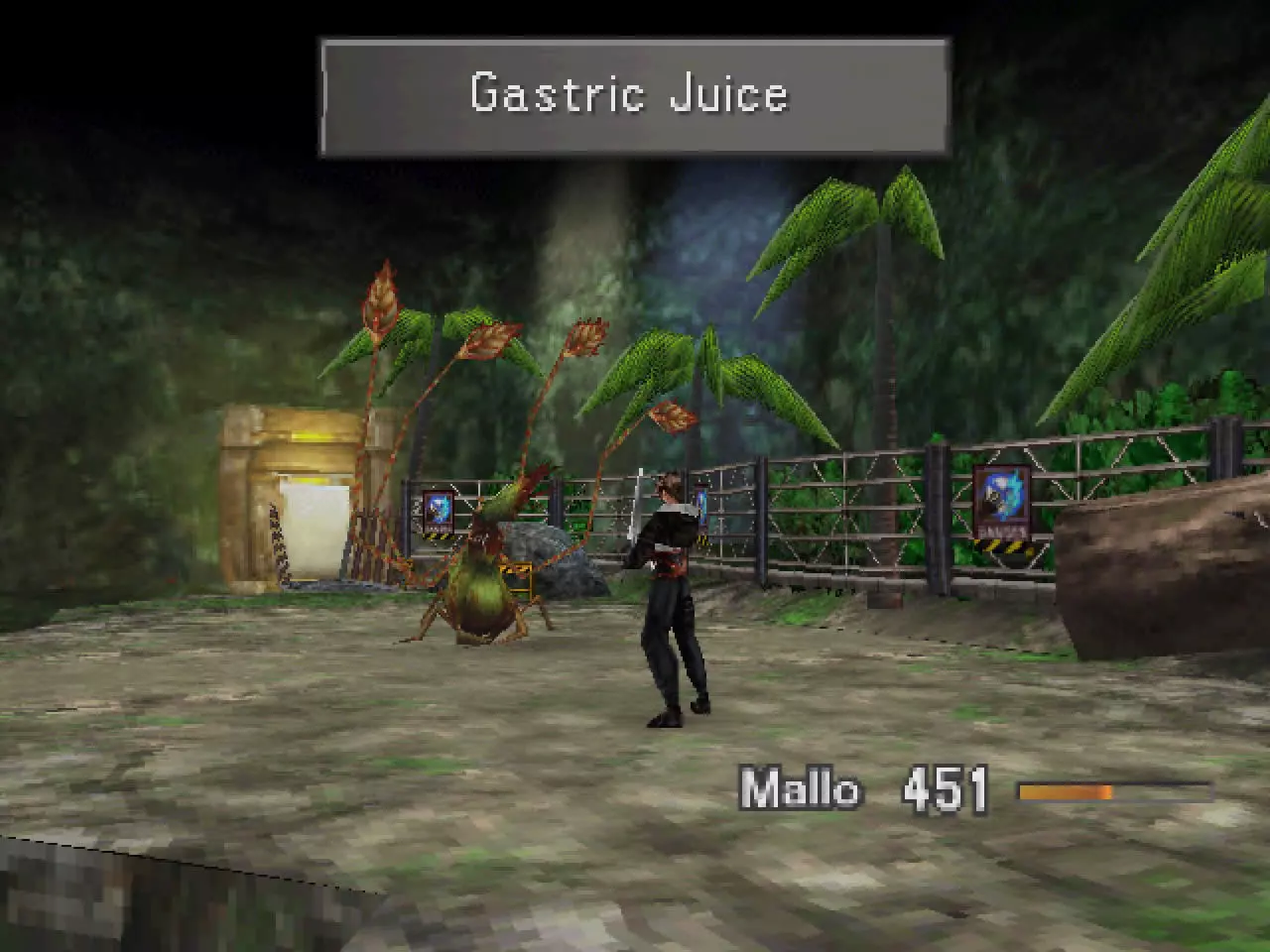Techniquement, ce composant repose sur une architecture parallèle complexe, combinant un CPU cadencé à 294 MHz et plusieurs coprocesseurs spécialisés. L’objectif ? Répartir les tâches graphiques et physiques pour offrir des performances inédites. Sur le papier, la PS2 devait écraser la concurrence, avec des environnements 3D riches, des animations fluides et des effets visuels spectaculaires.
Pourtant, cette puissance théorique cache une réalité bien plus nuancée. L’architecture parallèle de l’Emotion Engine, bien que novatrice, s’avère extrêmement difficile à maîtriser pour les développeurs. Habitués à des environnements plus classiques (comme ceux des PC ou de la Dreamcast), beaucoup se heurtent à une courbe d’apprentissage abrupte. Dompter ce "colosse" exige des mois d’adaptation, voire des années pour certains studios. Les premiers jeux peinent à exploiter pleinement son potentiel, laissant les joueurs sur leur faim malgré les promesses initiales.
Le Tokyo Game Show 1999 : le spectacle avant l’heure
En septembre 1999, Sony lève le voile sur la PS2 lors du Tokyo Game Show, dans une mise en scène digne d’un blockbuster. La console, au design épuré et anguleux, est présentée comme un objet du futur, à mi-chemin entre une console de jeu et un appareil hi-fi. Les annonces claquantes s’enchaînent : lecteur DVD intégré (une première dans l’industrie), compatibilité totale avec la PS1, ports d’extension pour disque dur et réseau, et une manette DualShock 2 améliorée. Mais c’est la promesse de 66 millions de polygones par seconde qui électrise l’assistance. Des démos techniques impressionnantes – visages animés, foules dynamiques, environnements détaillés – sont diffusées, alimentant l’imaginaire collectif. Pour le public, la PS2 incarne déjà la prochaine génération, même si la réalité est bien moins reluisante.
Les médias s’emballent, reprenant sans réserve les arguments marketing de Sony. Pourtant, ce chiffre phare de 66 millions de polygones est un maximum théorique, obtenu dans des conditions idéales (sans textures, sans ombres, et avec une intelligence artificielle minimale). Les premiers titres, comme Ridge Racer V, sont loin d’atteindre ce niveau de détail. Malgré tout, l’effet psychologique est dévastateur : la Dreamcast, pourtant plus performante en conditions réelles, est perçue comme déjà dépassée.
Un marché en suspens
À la fin des années 1990, le paysage du jeu vidéo est en pleine mutation. Sega a lancé sa Dreamcast, une console puissante et abordable, avec des jeux comme SoulCalibur ou Shenmue qui repoussent les limites techniques. Pourtant, malgré ses atouts, elle peine à s’imposer face à l’aura grandissante de la PS2. Les éditeurs hésitent à investir dans une plateforme dont l’avenir semble compromis par l’arrivée imminente de la machine de Sony. Nintendo, de son côté, planche sur son projet "Dolphin" (futur GameCube), tandis que Microsoft prépare secrètement sa première console, la Xbox.
Résultat : en 1999–2000, le marché est comme figé. La Dreamcast propose du concret, mais la PS2, encore absente des rayons, domine déjà les esprits. Sony a remporté la bataille psychologique avant même d’avoir livré une seule unité
Le double jeu de Sony
Pendant que la concurrence se débat, Sony continue de soutenir la PS1 avec des titres majeurs comme Final Fantasy VIII ou Gran Turismo 2. En coulisses, cependant, tous les efforts sont concentrés sur la PS2. La firme japonaise voit en elle bien plus qu’une simple console : un cheval de Troie multimédia, capable d’imposer le DVD, de consolider la domination de la marque PlayStation, et de verrouiller le marché grâce à sa rétrocompatibilité.
Aux États-Unis, le budget marketing alloué à la PS2 est pharaonique. Le slogan "Live in your world, play in ours" ne vend pas une console, mais un mode de vie. Sony ne parle plus de jeu vidéo, mais d’une expérience globale, mêlant divertissement, technologie et statut social.
66 millions de polygones : un leurre génial
un leurre génial L’annonce des 66 millions de polygones par seconde est un coup de maître. Bien que ce chiffre ne reflète pas les performances réelles (les premiers jeux tournent autour de 3 à 7 millions de polygones en conditions normales), il suffit à créer un mythe. Sega, malgré une Dreamcast techniquement supérieure en rendu pratique, ne peut rivaliser avec cette promesse de futur. Sony a compris une chose : en 1999, vendre du rêve compte plus que vendre des spécifications techniques.
La Dreamcast, victime collatérale
La Dreamcast est une console en avance sur son temps : puissante, innovante, et dotée d’une ludothèque déjà solide. Pourtant, elle subit de plein fouet l’effet "PS2". Les joueurs et les éditeurs, convaincus que la prochaine génération est déjà en marche, reportent leurs achats et leurs projets. Sega, malgré des ventes honorables, ne peut inverser la tendance. La Dreamcast devient la première victime d’une guerre qu’elle n’a pas vraiment pu livrer.