Semaine 1: Les Origines du mythe (incontournables)
Jeu 1 - Devil May Cry - Jeu 2 - Final Fantasy X - Jeu 3 - Silent Hill 2 - Jeu 4 - Ico - Jeux 5 - Metal Gear Solid : Snake Eater
Semaine 2: L’Âge d’or de la liberté (incontournables)
Jeu 1 - Shadow of the Colossus - Jeu 2 - Ōkami - Jeu 3 - God Of War II - Jeu 4 - Resident Evil 4 -jeu 5 - GTA San Andreas
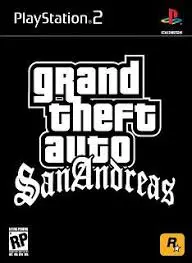
GTA: San Andreas
L’État qui racontait une trajectoire
Genèse et ambition
En deux épisodes sur PS2, Rockstar North a défini la grammaire du monde ouvert moderne : GTA III invente la ville jouable, Vice City lui donne du style. Pour le troisième acte, l’ambition grimpe d’un cran : changer d’échelle et changer de point de vue. On ne joue plus “une ville”, mais un État inspiré de la côte ouest — Los Santos, San Fierro, Las Venturas — relié par des autoroutes, des collines, des déserts, des villages. Surtout, on quitte la parodie pop 80’s pour 1992, année de tensions raciales, de corruption policière et de rap West Coast. L’objectif n’est pas seulement d’agrandir la carte : c’est de faire vivre une trajectoire — celle de Carl “CJ” Johnson, gamin du quartier qui revient chez lui et découvre que tout s’est fracturé pendant son absence.

Univers & récit — 1992, la famille, la rue, l’État
Retour à Los Santos. CJ débarque du taxi, apprend la mort de sa mère, retrouve Sweet, Ryder, Big Smoke, et un gang, les Grove Street Families, en lambeaux. Très vite, l’“ordre” local s’impose : Frank Tenpenny (policier pourri) tient la ville par l’intimidation. Trahisons, arrestations, exils forcés : la route de CJ l’emmène à San Fierro (filières, garages, ascension économique), puis à Las Venturas (casinos, casses, jeux d’alliances), avant le retour à Los Santos pour solder les comptes.
Le jeu parle de loyauté, d’opportunisme, de rêve américain de seconde zone. On y croise autant de masques grimaçants que de figures mémorables, et la galerie vocale y met un cachet rare : Samuel L. Jackson (Tenpenny), James Woods (Toreno), Peter Fonda (The Truth), MC Eiht (Ryder), Clifton Powell (Big Smoke), Faizon Love (Sweet), Axl Rose en DJ K-DST. La satire reste là, mais elle ne masque pas le fond : grandir, c’est choisir ce qu’on abandonne.

Gameplay — Le bac à sable qui a décidé d’ajouter du “RPG”
San Andreas conserve la liberté des deux premiers épisodes, mais y ajoute des mécaniques qui racontent la progression d’un personnage. Chaque système sert l’idée centrale : on ne se contente plus d’explorer, on devient quelqu’un.
➤ Corps et stats — Muscu, course, natation : tout se voit et change les animations. Grossir ou maigrir modifie la vitesse et la façon dont les PNJ vous regardent, ce qui rend le corps joueur tangible dans le monde.
➤ Compétences — Conduite, tir, pilotage s’améliorent par la pratique. La flight school, par exemple, transforme la peur du ciel en maîtrise concrète : apprendre devient une récompense jouable.
➤ Apparence sociale — Vêtements, coiffures, tatouages influencent les réactions des habitants et ouvrent ou ferment des interactions. L’esthétique devient un signal social, pas seulement de la cosmétique.
➤ Territoires — Les reprises de quartiers rendent la guerre de gangs lisible et stratégique : contrôler un bloc change les revenus, la sécurité et la circulation des missions. La carte devient un enjeu politique.
➤ Tuning et véhicules — Les lowriders et personnalisations nourrissent la culture locale et génèrent des activités annexes (courses, concours) qui ancrent le joueur dans sa communauté.
➤ Braquages et missions en plusieurs étapes — Les casses à Las Venturas demandent préparation et coordination, annonçant les grandes séquences scénarisées que la série développera ensuite.
➤ Objets-ludiques et échappées — Jetpack, avions, BMX, casinos : autant de pauses qui varient le rythme sans rompre la cohérence du monde.
Résultat : les progrès techniques et sociaux de CJ déterminent les histoires accessibles. On ne débloque pas seulement des missions : on forge une identité qui change la manière dont le monde vous accueille.

Les dessous de la production — Faire tenir un État dans 32 Mo
Raconter San Andreas, c’est aussi raconter comment Rockstar a bricolé de la magie technique pour que la PS2 donne l’illusion d’un État vivant. Le mot d’ordre pendant le développement n’était pas « tout simuler », mais « faire sentir » : créer l’impression d’un monde continu sans écraser la console.
• Streaming et chargement progressif
Plutôt que charger la carte entière, le moteur envoie et retire des morceaux de données en temps réel au fur et à mesure que vous roulez. Routes, décor, trafic et scripts de mission arrivent « à la demande » : c’est ce streaming qui donne l’effet de continuité quand vous traversez la carte.
• Niveaux de détail et occultation
Pour économiser la mémoire et le calcul, les modèles lointains sont simplifiés (LOD) et certains objets sont masqués jusqu’à ce qu’ils deviennent proches. D’un point de vue joueur, cela peut se lire comme un voile qui se lève sur le paysage plutôt qu’un bug — un compromis astucieux entre lisibilité et contraintes techniques.
• Routines PNJ et réactions locales
Les piétons ne sont pas des clones : ils ont des comportements liés à leur zone (travail, promenade, réactions face au crime). Les policiers suivent des paliers d’alerte qui modifient leurs comportements et l’apparence des rues. Ces routines, simples mais coordonnées, donnent une impression de vie quotidienne crédible.
• Systèmes reliés par états plutôt que par une IA lourde
Plutôt que d’avoir une intelligence omnisciente, San Andreas relie des sous‑systèmes (gangs, police, économie des quartiers, casinos) par des états partagés et des déclencheurs. Quand un gang perd du terrain ou qu’un braquage réussit, des états changent et entraînent des conséquences visibles — sans coût computationnel exorbitant.
• Optimisations créatives
Des astuces techniques (scripts légers, événements déclenchés via zones, animation réutilisable) multiplient l’effet sans multiplier les ressources. Le résultat ressemble à un petit écosystème où chaque mécanisme, même simple, produit de la complexité apparente.
• Contexte et polémiques
Les débats autour du fameux « Hot Coffee » ont focalisé l’attention médiatique, mais n’effacent pas la prouesse technique : San Andreas reste d’abord une démonstration d’ingénierie du monde qui montre comment concevoir de la profondeur avec des moyens limités.

Réception critique & succès
Notes hautes, presse unanime sur la générosité et l’ampleur. Quelques réserves sur le framerate et l’aliasing, mais l’ambition écrase les défauts. Côté ventes, le verdict est historique : meilleur score de la PS2 et l’un des jeux les plus vendus de tous les temps. La longévité sera entretenue par les versions ultérieures (PC, Xbox, mobiles, rééditions), tant l’ossature reste solide.
Héritage — Le monde ouvert “vie quotidienne”
San Andreas a imposé l’idée que l’open world n’est pas qu’un terrain de mission, c’est une vie entre les missions : s’habiller, manger, s’entraîner, rouler pour le plaisir, flâner… Il a préparé la bascule GTA IV/V en fixant une échelle et une densité de références culturelles que tout le monde copiera. S’il faut un symbole de la PS2 à son apogée, c’est bien celui-là : un jeu où l’on peut rentrer chez soi, regarder le quartier, et décider de ce qu’on veut devenir.
